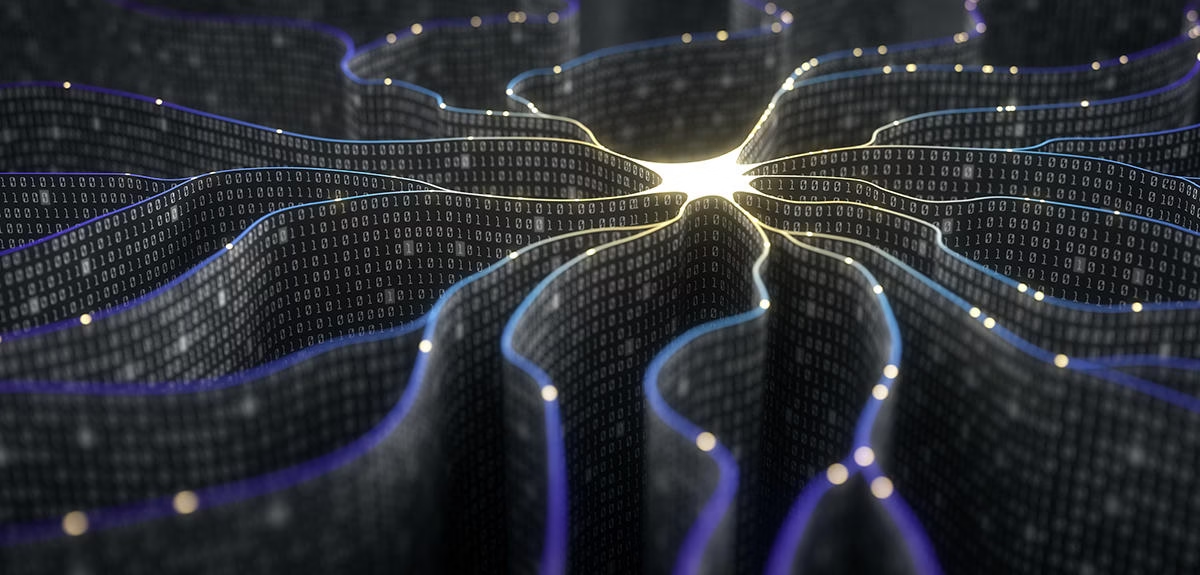À l’époque des encyclopédies participatives, des IA conversationnelles et de l’infobésité algorithmique, le monde semble crouler sous le poids du savoir. En un clic, Wikipédia répond, en un prompt, ChatGPT résume, en quelques scrolls, TikTok vulgarise. Pourtant, ce déluge informationnel ne fait pas de nous des êtres plus éclairés. Il nous submerge, nous égare, nous donne l’illusion de comprendre, là où souvent nous ne faisons que répéter.
Derrière cette confusion se cache une fracture fondamentale : celle entre savoir et connaissance. Le savoir est accumulation ; la connaissance, transformation. Le premier compile, le second questionne. Le savoir est donné ; la connaissance est conquise.
Dans cet article, nous allons explorer en profondeur cette mutation du rapport au savoir : pourquoi l’ère numérique produit-elle plus d’information mais moins de compréhension ? Comment les promesses universalistes de Diderot se sont-elles transformées en architecture mondiale du savoir biaisée ? En quoi la révolution de l’intelligence artificielle rebat-elle les cartes de la légitimité cognitive ? Et surtout : comment passer, individuellement et collectivement, d’un savoir qui s’accumule à une connaissance qui éclaire ?
Table of Contents
ToggleHéritage des Lumières : promesse de savoir ou mythe de la raison universelle ?
Le XVIIIe siècle européen, souvent glorifié comme le siècle des Lumières, fut le théâtre d’une révolution intellectuelle sans précédent. Philosophes, encyclopédistes et savants ambitionnaient de libérer l’humanité des ténèbres de l’ignorance par la seule force de la raison. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert en devint l’icône : un projet monumental visant à compiler, organiser et diffuser l’ensemble du savoir humain, sous le sceau de l’universalisme. Mais cette entreprise — aussi ambitieuse que fondatrice — portait en elle les germes d’une contradiction épistémique majeure.
Car si les Lumières affirmaient vouloir éclairer « tous les hommes », ce projet universaliste reposait en réalité sur une anthropologie restreinte : celle de l’homme blanc, européen, lettré, masculin. Le reste du monde — Afrique, Amériques, Asie — fut souvent exclu, folklorisé ou classifié selon les logiques hiérarchisantes de la pensée coloniale naissante. Le savoir promu n’était pas le savoir, mais un savoir : celui des élites occidentales, érigé en norme.
Ainsi, sous couvert de raison et de science, les Lumières ont construit une hégémonie cognitive où la prétention à l’universel masquait un profond ethnocentrisme. Cette illusion d’un savoir neutre, désincarné, et objectivement transmissible, a justifié l’effacement ou la disqualification de formes de connaissances alternatives : orales, communautaires, spirituelles, intuitives, indigènes. En cela, l’héritage des Lumières ne peut être abordé sans une lecture critique : il est à la fois émancipateur et mutilant, porteur de progrès mais aussi de domination.
Ce mythe fondateur continue aujourd’hui d’influencer nos manières de penser. Lorsque nous consultons Wikipédia, ce descendant direct de l’Encyclopédie, nous retrouvons cette logique encyclopédique des Lumières : classification, standardisation, objectivation. Mais dans quelle mesure cet héritage reproduit-il encore une vision biaisée du monde, où certaines voix sont surreprésentées tandis que d’autres sont marginalisées, voire invisibilisées ?
Revenir à l’esprit des Lumières, c’est donc moins célébrer une époque que repenser son legs : comment transformer cette quête du savoir en un projet véritablement pluriel, critique et inclusif ? Comment ouvrir l’encyclopédisme à d’autres formes de rationalité, d’humanité et de mémoire ?
De Wikipédia à l’IA : nouvelles Lumières ou vieux biais masqués par le progrès ?
En apparence, notre époque vit une nouvelle Renaissance du savoir. Wikipédia incarne l’idéal d’un savoir ouvert, collectif, accessible à tous. L’intelligence artificielle, quant à elle, promet une rationalisation accélérée de l’information, une capacité de traitement surhumaine, une objectivité algorithmique. Mais derrière cette illusion d’un progrès inéluctable et neutre, se rejouent en sourdine les vieux mécanismes d’exclusion, de centralisation et de standardisation du savoir — dans la droite lignée des Lumières, mais avec des outils d’une puissance inédite.
Prenons Wikipédia. Son ambition encyclopédique rappelle celle de Diderot : organiser la totalité du savoir humain. Mais en réalité, la majorité des contributions proviennent d’une minorité d’utilisateurs — hommes blancs occidentaux, souvent issus de milieux éduqués. Résultat : une surreprésentation des savoirs occidentaux, scientifiques ou universitaires, et une sous-représentation massive des connaissances orales, locales, spirituelles, traditionnelles ou minoritaires. Les biais de genre, de classe, de race ou de géographie ne sont pas des accidents : ils sont structurels, ancrés dans l’architecture même du projet.
Quant à l’intelligence artificielle, elle repose sur des bases de données produites par l’homme — et donc chargées de ses angles morts, de ses préjugés, de ses exclusions passées. Les IA génératives, censées produire du contenu « objectif », recyclent en réalité les stéréotypes encodés dans leurs corpus d’apprentissage. Loin de corriger les biais, elles les perpétuent, parfois à une échelle industrielle, et sous une forme plus insidieuse encore : celle de l’autorité technique, de la prétendue neutralité mathématique.
Ainsi, la technologie ne fait pas table rase du passé : elle l’amplifie. L’algorithme devient le nouveau clerc ; le code, la nouvelle liturgie du vrai ; les géants du numérique, les nouveaux encyclopédistes. Et pourtant, l’inclusion, la diversité épistémique, la mémoire des savoirs subalternes restent en marge. Le progrès n’est pas toujours synonyme d’émancipation : il peut aussi n’être qu’un miroir sans tain où les dominations d’hier s’infiltrent dans les langages de demain.
En vérité, nous ne sommes pas sortis des Lumières : nous en vivons l’ombre prolongée, transposée dans un univers numérique. La rationalité technologique est-elle une promesse d’égalité ou un raffinage des exclusions passées ? Nos intelligences artificielles sont-elles vraiment universelles, ou simplement plus efficaces à reproduire l’ordre établi ?
La fracture des savoirs : entre la bibliothèque coloniale et les voix étouffées
Dans la cartographie globale du savoir, toutes les connaissances ne se valent pas — et toutes n’ont pas eu, ni n’ont encore, le droit à l’existence légitime. Derrière les vitrines scintillantes de l’universalité du savoir, se cache une bibliothèque coloniale, silencieuse mais puissante, qui continue de hiérarchiser, d’exclure, d’invisibiliser.
La modernité occidentale, en se posant en arbitre du vrai et du faux, a imposé ses catégories épistémologiques comme des normes absolues. Le savoir rationnel, expérimental, écrit — celui des académies, des laboratoires, des archives — a été élevé au rang de vérité, reléguant les formes alternatives de connaissance (orale, intuitive, spirituelle, communautaire) au statut de folklore ou de superstition. L’Afrique, l’Asie, les Amériques précolombiennes ou les sociétés autochtones n’étaient pas considérées comme détentrices de savoirs, mais comme objets d’étude. On leur a nié l’épistémè, on leur a volé l’autorité de dire le monde.
Ce processus, amorcé dès les premières conquêtes, s’est cristallisé dans l’entreprise encyclopédique occidentale. La bibliothèque coloniale, pour reprendre l’expression de Mudimbe, a classé, renommé, interprété les mondes non-européens selon des grilles de lecture exogènes. La science coloniale ne fut pas seulement un outil de domination matérielle : elle fut une entreprise de réécriture du réel. Jusqu’à faire croire à des peuples entiers qu’ils n’avaient pas d’histoire avant l’arrivée du colon, pas de science avant l’imprimerie, pas de philosophie sans Platon.
Aujourd’hui encore, cette fracture épistémique perdure. Dans les universités, les programmes restent largement centrés sur les auteurs occidentaux. Dans les systèmes éducatifs postcoloniaux, on apprend à penser selon des schémas importés, souvent inadaptés aux réalités locales. Et dans les algorithmes, les langues dominantes écrasent les idiomes minoritaires. Même les bases de données de l’intelligence artificielle sont bâties sur des corpus où les savoirs non-occidentaux sont sous-représentés, traduits, décontextualisés — donc appauvris.
Mais les voix étouffées commencent à se faire entendre. Les savoirs indigènes, les cosmologies africaines, les épistémologies féministes ou décoloniales réclament leur droit d’exister, de penser, de transmettre sans filtre. Des bibliothèques orales renaissent, des narrations autochtones s’affirment, des intellectuels réhabilitent les connaissances enfouies sous des siècles d’oubli imposé. Le combat n’est plus seulement politique ou économique : il est aussi symbolique. Car celui qui nomme le monde le possède.
La fracture des savoirs n’est pas un accident de l’histoire : c’est un champ de bataille. Et aujourd’hui plus que jamais, la vraie question est la suivante : qui a le droit de savoir, de dire, et d’être cru ?
Du savoir au pouvoir : comment la connaissance devient arme d’hégémonie
Il n’existe pas de savoir neutre. Derrière chaque corpus, chaque narration, chaque vérité officielle, se cache un enjeu de pouvoir. Toute connaissance est située, orientée, produite dans un contexte donné — et bien souvent, instrumentalisée pour asseoir des dominations. Le savoir n’est pas qu’un outil pour comprendre le monde : il est une arme pour le gouverner.
Depuis les Lumières, l’Occident s’est imposé comme le dépositaire de la rationalité universelle. L’entreprise encyclopédique, saluée pour son ambition intellectuelle, était aussi une entreprise d’unification du vrai selon des critères précis : la méthode expérimentale, la raison, la preuve écrite. Derrière cette quête du savoir pur, se jouait une autre dynamique : celle de la centralisation cognitive. L’Europe ne se contentait pas de découvrir le monde, elle le nommait, le cartographiait, l’ordonnait. Elle en faisait un système dont elle détenait les clefs.
Ce lien entre savoir et pouvoir s’est exacerbé avec la modernité industrielle, les sciences sociales, l’économie politique ou encore la biologie. La classification des races, les théories évolutionnistes appliquées aux civilisations, ou l’invention du « développement » comme critère de hiérarchisation des peuples, sont autant d’exemples où la connaissance a été façonnée pour légitimer la domination. On ne colonisait pas seulement des terres : on colonisait aussi des esprits. Et on le faisait par l’école, les cartes, les dictionnaires, les statistiques, les rapports scientifiques.
Dans le monde contemporain, cette logique persiste — mais sous des formes plus subtiles. Celui qui maîtrise l’information contrôle les récits. Les grandes puissances détiennent les bases de données mondiales, les revues scientifiques, les moteurs de recherche, les plateformes de diffusion du savoir. L’anglais s’est imposé comme langue hégémonique de la recherche. Wikipédia, Google, JSTOR ou PubMed définissent ce qui est visible, donc ce qui est crédible. L’intelligence artificielle, en reproduisant ces biais, automatise cette domination.
La connaissance devient un levier d’influence géopolitique. Les classements des universités dictent les flux d’étudiants internationaux. Les grandes revues académiques filtrent les théories légitimes. Les normes ISO, les standards scientifiques, les critères de validation émanent toujours du même pôle civilisationnel. Même dans les débats mondiaux (climat, santé, économie), les voix du Sud sont souvent cantonnées au rôle de récepteurs ou de victimes, rarement d’experts.
Mais à cette centralisation répond une résistance : celle des savoirs pluriels, insurgés, décentrés. Aujourd’hui, des intellectuels africains, asiatiques, autochtones, queer ou diasporiques déconstruisent la fiction de l’universalisme. Ils revendiquent une épistémologie située, ancrée, contextuelle. Ils rappellent que le savoir, pour être libérateur, doit être plurilingue, pluriel, polyphonique.
La connaissance peut asservir. Mais elle peut aussi émanciper. Tout dépend de qui l’émet, pour qui elle est pensée, et contre quoi elle s’élève. Car comme le disait Foucault : “le savoir est pouvoir” — mais il peut aussi être contre-pouvoir.
Vers un nouvel humanisme épistémique ?
Si le projet des Lumières a forgé une modernité centrée sur la raison, le savoir et la liberté, il est aujourd’hui urgent de penser un nouveau pacte de connaissance : non plus vertical, occidentalocentré et prétendument neutre, mais dialogique, pluriel et conscient de ses angles morts. L’humanité, pour faire face aux défis du siècle — climatiques, technologiques, géopolitiques, spirituels — ne peut plus se contenter d’un savoir hégémonique, désincarné et uniformisant. Il nous faut réinventer un humanisme épistémique.
Ce nouvel humanisme ne postule pas une Vérité unique à imposer, mais reconnaît la coexistence de vérités situées, issues de trajectoires historiques, culturelles et existentielles distinctes. Il ne rejette pas la science, mais l’inscrit dans une éthique du doute, de la responsabilité et de l’humilité. Il ne nie pas la rationalité, mais la complète par l’imaginaire, la mémoire, la spiritualité et le sensible.
Cela implique de revaloriser les savoirs locaux, indigènes, féminins, populaires, longtemps considérés comme « non légitimes ». Cela exige aussi de repenser les institutions productrices de savoir — universités, encyclopédies, intelligences artificielles — pour les rendre plus inclusives, transparentes et réflexives. L’enjeu est de faire du savoir un espace de justice, et non de domination.
Dans cette perspective, la connaissance devient une passerelle entre les mondes plutôt qu’une frontière. Elle cesse d’être une arme de distinction pour devenir un langage commun, ouvert, évolutif. Ce nouvel humanisme épistémique ne sera pas une table rase, mais une table ronde : où les Lumières de Kant, les récits Dogon, les poésies de Tagore, les chants Tikar ou les mathématiques de l’Inde dialoguent enfin — non pas pour s’uniformiser, mais pour s’enrichir.
Il ne s’agit plus seulement de savoir, mais de co-naître : naître ensemble à un monde plus lucide, plus humble, plus solidaire. Et peut-être, enfin, plus humain.