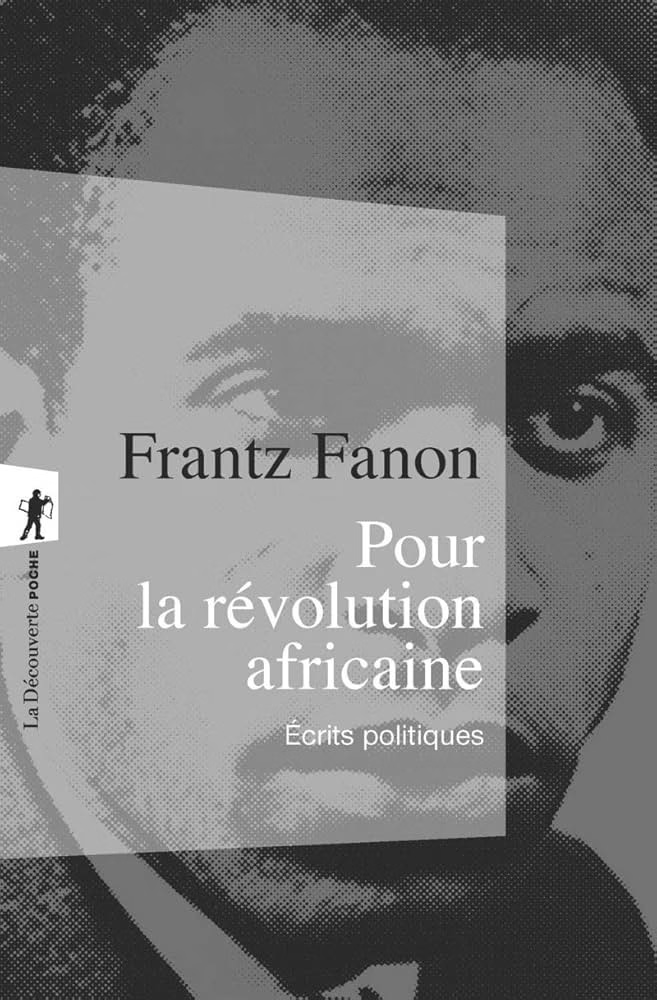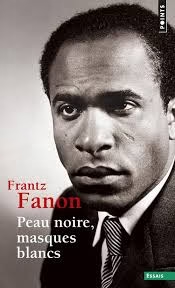Le 2 avril 2025, le film Fanon a fait irruption dans les salles françaises comme une détonation. En métropole, dans les Antilles, en Guyane et bientôt en Afrique francophone (11 avril 2025), ce biopic bouleverse les codes du genre pour incarner à l’écran l’un des intellectuels les plus radicaux du XXe siècle : Frantz Fanon. Pensée, chair et mémoire s’entremêlent dans une œuvre cinématographique qui n’a rien d’un hommage tiède. Ce n’est pas un film de musée, c’est une claque, un cri. Et surtout, une leçon d’Histoire avec un grand H.
Réalisé après dix ans de recherches et de batailles de production, Fanon n’est pas qu’un simple portrait : c’est un manifeste. Le film retrace le parcours de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, engagé dans les luttes anti-coloniales, théoricien de la violence émancipatrice et auteur du mythique Les Damnés de la terre. De sa jeunesse aux Antilles à son engagement aux côtés du FLN algérien, le récit adopte un rythme haletant, sans jamais trahir la complexité de la pensée fanonienne.
Le scénario prend soin de mêler la rigueur intellectuelle au souffle romanesque. On y découvre Fanon dans ses contradictions, ses convictions et ses combats. Incarné avec intensité par un acteur encore méconnu mais d’une puissance rare. Loin d’un récit linéaire, le film utilise des ruptures de ton, des archives, des flashbacks et une narration fragmentée qui rappelle parfois le Fanon lui-même : lucide, dérangeant, indomptable.
Fanon, ce n’est pas juste un film.
C’est une mémoire réactivée.
C’est l’histoire d’un homme qui a voulu panser les plaies de son peuple en dénonçant les chaînes de l’oppression.
Et c’est maintenant à nous d’écouter ce qu’il a à dire.
Table of Contents
ToggleUne jeunesse martiniquaise marquée par la guerre
Né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique, Frantz Fanon grandit dans une famille de classe moyenne dans une colonie française. Très jeune, il est confronté aux contradictions de la société coloniale : un système qui prône l’assimilation tout en maintenant des hiérarchies raciales et culturelles profondément ancrées.
À 18 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, Fanon s’engage dans les Forces françaises libres pour combattre le nazisme. Il y découvre un paradoxe cruel : même en luttant contre le racisme fasciste, les soldats noirs sont méprisés par l’armée coloniale française. Cette expérience constitue l’un des premiers chocs identitaires majeurs de sa vie.
Le militant révolutionnaire et penseur de la décolonisation
Après la guerre, Fanon poursuit ses études de médecine à Lyon, où il se spécialise en psychiatrie. Très vite, il se distingue par une approche novatrice, refusant la psychiatrie racialisée et autoritaire de l’époque. Il écrit Peau noire, masques blancs en 1952, une œuvre précoce mais décisive dans laquelle il analyse les effets psychiques du racisme sur les populations colonisées. Il y développe une critique lucide de l’aliénation culturelle et de la haine de soi induite par la colonisation.
En 1953, il devient médecin-chef à l’hôpital de Blida-Joinville, en Algérie. Il y met en place des méthodes thérapeutiques humanistes, centrées sur la parole et la réinsertion sociale. Mais très vite, la guerre d’indépendance éclate, et Fanon découvre que la psychiatrie coloniale est un champ de bataille symbolique. Les troubles mentaux sont indissociables des violences sociales infligées par le système colonial.
En 1956, Fanon démissionne de ses fonctions hospitalières. Dès lors, il rejoint activement le Front de Libération Nationale (FLN), mouvement indépendantiste algérien. Il devient rédacteur en chef de El Moudjahid, organe de presse du FLN, et ambassadeur itinérant du mouvement en Afrique noire. Fanon œuvre à créer des passerelles entre les luttes africaines et les combats anticoloniaux à l’échelle mondiale. Il appelle à une solidarité révolutionnaire Sud-Sud, préfigurant les mouvements panafricanistes contemporains.
Le colonisé réussit, par l’intermédiaire de la religion, à ne pas tenir compte du colon. […] Il accède à une sérénité de pierre.
– Les Damnés de la Terre (1961)
Les Damnés de la terre, testament d’un homme debout
Frappé par une leucémie fulgurante, Fanon dicte en quelques semaines Les Damnés de la terre, publié en 1961, quelques jours avant sa mort. Préfacé par Jean-Paul Sartre, le livre est aussitôt censuré en France, considéré comme un appel à la violence. Pourtant, l’ouvrage va bien au-delà d’une simple apologie de la révolte : il pose les fondements philosophiques, politiques et psychologiques de la libération des peuples opprimés.
Fanon y affirme que la décolonisation est un processus fondamentalement violent, non par goût du sang, mais parce qu’elle représente un bouleversement total de l’ordre imposé. Il y critique également les futures élites postcoloniales, accusées de reproduire les mécanismes de domination occidentale une fois au pouvoir.
Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence.
– Les Damnés de la Terre (1961)
Héritage et actualité d’une pensée toujours en lutte
Frantz Fanon meurt à 36 ans, le 6 décembre 1961, mais son héritage intellectuel est immense. Il inspire les Black Panthers, les mouvements anti-apartheid, les luttes palestiniennes, caribéennes, et plus récemment, les mouvements décoloniaux en Europe et en Amérique.
Aujourd’hui encore, ses écrits sont mobilisés dans les débats sur le racisme systémique, les violences policières, la mémoire coloniale et la condition noire. Fanon n’est pas seulement un penseur historique : il est un compagnon de route pour celles et ceux qui refusent de plier devant l’injustice.
La praxis qui les a jetées dans un corps à corps désespéré confère aux masses un goût vorace du concret. »
– Les Damnés de la Terre (1961)
Fanon, l’homme, le psychiatre, le révolutionnaire
L’une des grandes réussites du film réside dans sa capacité à restituer la pluralité de Fanon. En effet, il était médecin, penseur, militant, poète aussi. Le biopic n’élude pas son engagement psychiatrique à Blida, où il expérimenta des méthodes novatrices auprès de patients algériens, en pleine guerre coloniale. On y voit le Fanon médecin aux prises avec la souffrance des colonisés.
Mais c’est aussi le Fanon écrivain que le film met en lumière. Celui de Peau noire, masques blancs, celui de L’An V de la révolution algérienne. Celui qui écrit avec son corps malade (Les Damnés a été dicté sur son lit de mort). Ce Fanon-là refuse le statut de victime. Il prône la révolte, l’action, la transformation du monde, au prix du sang s’il le faut. Le film ne cache rien de cette radicalité.
Frantz Fanon fut tout à la fois un analyste des âmes blessées et un praticien de l’humain. Ce fut également un révolutionnaire radical et un écrivain incandescent. Sa vie fut courte, mais ses idées demeurent parmi les plus audacieuses et les plus actuelles pour penser un monde affranchi des dominations.
Redécouvrir Fanon, c’est se reconnecter à la profondeur des luttes passées pour mieux affronter les défis présents.
Quand elles ont participé, dans la violence, à la libération nationale, les masses ne permettent à personne de se présenter en “libérateur”. »
– Les Damnés de la Terre (1961)
Une œuvre politique, un miroir contemporain
Pourquoi Fanon résonne-t-il autant aujourd’hui ? Parce que les questions qu’il posait dans les années 1950, identité, racisme systémique, néo-colonialisme, domination occidentale, restent brûlantes. Dans une époque traversée par les violences policières, les injustices postcoloniales et les révisions historiques, Fanon agit comme un électrochoc.
Ce biopic tombe à pic dans le contexte d’une jeunesse africaine en quête de repères. Il offre une figure de radicalité assumée, loin des récits de résilience passive ou d’intégration apolitique. Fanon, c’est le refus de plier. Frantz Fanon n’est pas récupéré, il est réactivé. Et c’est toute la force du film : faire du passé un feu, pas une statue.